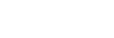Constat d’infraction
Plaider coupable ou être déclaré coupable pour un constat d’infraction n’entraîne pas de casier judiciaire. Ainsi, la culpabilité pour un constat d’infraction n’entraine pas les mêmes conséquences que celle pour une accusation criminelle.
La conséquence concrète d’être déclaré-e coupable d’une infraction à un règlement municipal, c’est d’avoir une dette monétaire envers le percepteur des amendes de la juridiction où le constat a été délivré. Cette dette, si elle demeure impayée, met à risque de saisie et, dans certains cas, à risque d’emprisonnement.
Le montant du constat d’infraction pourrait augmenter considérablement si aucune mesure n’est prise pour l’acquitter. À chaque étape judiciaire, des frais s’ajoutent au montant initial du constat. Les délais entre chaque étape varient d’une cour municipale à l’autre. De plus, si une personne a contesté le constat d’infraction, mais a quand même été trouvée coupable par le ou la juge, des frais d’environ 100$ sont généralement ajoutés à ce montant. À la fin du parcours judiciaire, le montant du constat peut avoir doublé ou même triplé.
Il est important, en cas d’incapacité financière de payer l’amende, de prendre des arrangements, comme il est expliqué dans la prochaine section. Autrement, un bref de saisie peut être émis. Un huissier peut venir à la résidence de la personne en défaut de paiement pour vérifier si elle est saisissable.
Plusieurs biens sont insaisissables, tels que la nourriture, les vêtements nécessaires, les meubles utilisés au quotidien, ainsi que les objets personnels de votre choix d’une valeur totale de 7 000$. Les instruments de travail nécessaires à l’exercice de votre profession, par exemple des outils, une automobile ou un ordinateur, sont aussi insaisissables. En cas de dette inférieure à 20 000$, la résidence principale est également insaisissable. Par contre, une partie du salaire peut être saisie.
Au Québec, une personne qui ne payait pas ses constats pouvait jusqu’à récemment être emprisonnée pour non-paiement d’amende. Le milieu communautaire lutte depuis plus d’une décennie pour mettre fin à ce type d’emprisonnement pour les personnes en situation d’itinérance et de vulnérabilité. Montréal a mis fin à l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes depuis des années et Val-d’Or a suivi le pas plus récemment. La ville de Québec a pour sa part adopté un moratoire pour les personnes en situation d’itinérance ou vivant avec des problématiques de santé mentale (CERP, p. 17).
Toutefois, partout ailleurs, l’emprisonnement était toujours possible jusqu’à juin 2020. À ce moment, le Code de procédure pénale a finalement été modifié pour restreindre l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes seulement aux cas où « le défendeur [ou la défenderesse] a, sans excuse raisonnable, refusé ou négligé de payer ces sommes » (PL 32, art.53). C’est dire qu’une personne incapable de payer ses constats ne pourra plus être emprisonnée. Bien que ce soit une bonne nouvelle, il faudra en surveiller l’application par les tribunaux.

Infraction criminelle
Les conséquences d’être déclaré-e coupable d’une infraction criminelle varient selon le type d’infraction et les circonstances spécifiques du dossier. Le Code criminel crée trois types d’infraction :
- les accusations portées par voie sommaire, qui sont les moins graves et passibles de peines moins sévères;
- les accusations par acte criminel, qui sont considérées les plus graves et passibles de peines plus sévères;
- les infractions dites hybrides ou mixtes, où la poursuite à la discrétion selon les circonstances de procéder par voie sommaire ou par acte criminel.
La plupart des accusations portées contre des manifestant-e-s sont hybrides, notamment participer à une émeute (art. 65), entraver le travail des policiers et policières (art. 129) ou commettre un méfait (art. 430).
La gamme des peines applicables aux infractions criminelles est vaste et la peine imposée dépend des circonstances propres à chaque accusé-e de même qu’au contexte dans lequel l’infraction a été commise. La peine peut aller de l’imposition d’une amende ou de travaux communautaires jusqu’à des peines plus sévères comme l’incarcération. Les peines d’incarcération sont cependant rares lorsqu’il s’agit de condamnations découlant de mobilisations sociales.
Une condamnation criminelle entraîne généralement un casier judiciaire qui peut avoir pour conséquence d’entraver l’accès à certains emplois, à la citoyenneté ou à certains voyages à l’étranger (Éducaloi).
Toutefois, il est parfois possible d’obtenir une absolution, assortie ou non de conditions. Dans ce cas, la personne reconnue coupable n’a pas de casier judiciaire. Une telle peine n’entraîne pas de casier judiciaire, malgré la déclaration de culpabilité (Doyon, para 49). La personne ayant obtenu une absolution qui exerce une profession réglementée (avocat-e, infirmier ou infirmière, etc.) devra toutefois la déclarer à son ordre professionnel (Doyon, para 45).
Dans le cas d’une absolution conditionnelle, les États-Unis peuvent refuser l’entrée sur le territoire. L’accusé-e devra alors démontrer qu’il en va de son « intérêt véritable », parce qu’un casier judiciaire lui ferait perdre son emploi ou l’empêcherait d’exercer le métier pour lequel il ou elle étudie, par exemple.
La destruction du dossier judiciaire
En cas d’acquittement ou d’absolution, il est possible de demander la destruction du dossier constitué par le service de police et de restreindre l’accès du public aux informations contenues dans les registres informatisés de la cour.
La demande de destruction du dossier se fait par écrit auprès du service de police concerné. Chaque service de police possède ses propres procédures et rend parfois des formulaires disponibles à cet effet (voir par exemple SPVM, Destruction de dossier).
Le délai applicable à une telle demande dépend de l’issue du dossier. En cas d’acquittement, la demande de destruction de dossier sera recevable deux mois après le jugement final. En cas d’absolution sans condition, un délai de 12 mois est requis avant de pouvoir déposer une demande de destruction. En cas d’absolution assortie de conditions, la demande ne pourra être faite qu’après 36 mois.
L’accès aux registres informatiques de la Cour
Il est également possible de demander que les informations concernant les procédures judiciaires contenues aux registres informatisés de la cour ne soient plus accessibles au public.
La demande est faite en remplissant un formulaire qui est déposé au greffe de la cour concernée (MJQ, Demande de non-communication).
La demande de non-communication des renseignements est soumise aux mêmes délais que la demande de destruction du dossier de police.
La suspension du casier judiciaire
Rappelons que la peine imposée à une personne déclarée coupable d’une infraction criminelle entraîne un casier judiciaire, sauf si la peine est une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. Un casier judiciaire ne s’efface pas à proprement parler, mais il est possible de rendre les informations inaccessibles par le biais d’une demande de suspension de casier judiciaire (anciennement le pardon) à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (Loi sur le casier judiciaire, art. 4 (3.1)).
Une telle demande peut être présentée cinq ans après la fin de la peine s’il s’agit d’une accusation ayant été portée par voie sommaire ou 10 ans après la peine lorsque l’accusation a été portée par acte criminel. La peine doit avoir été pleinement purgée : l’incarcération doit être terminée, les travaux communautaires complétés ou les amendes et suramendes complètement payées. Le formulaire est disponible en ligne (Gouvernement du Canada).
La présentation d’une demande de suspension de casier implique des dépenses importantes :
- En 2020, les frais de service exigés pour le traitement des demandes sont de 644,88$.
- Des frais variant entre 50$ et 90$ sont à prévoir pour la prise d’empreintes digitales et l’obtention d’une copie de votre casier judiciaire.
- D’autres frais peuvent également s’ajouter pour l’obtention de certains documents judiciaires et la vérification des dossiers du corps policier impliqué dans l’arrestation.
Avant de rendre sa décision, la Commission évalue la conduite de la personne depuis sa condamnation et le « bénéfice mesurable » que la suspension de son casier judiciaire lui apporterait (Loi sur le casier judiciaire, art. 4.1 (2)). La personne devra d’une part montrer à la Commission qu’elle n’a plus de démêlés avec le système judiciaire.
D’autre part, elle devra convaincre la Commission que la suspension lui sera bénéfique, par exemple pour la libérer du stigmate découlant d’une condamnation criminelle, lui permettre d’accéder ou de postuler à un meilleur emploi ou encore faciliter les voyages aux États-Unis. Le délai de traitement des demandes de suspension de casier judiciaire est de 12 à 18 mois.
[1] Le Code criminel crée ces trois catégories d’infractions (sommaire, acte criminel ou hybride) qui déterminent le tribunal compétent, la procédure applicable et la gravité des peines possibles.
[2] Les accusations portées par voie sommaire sont les moins graves, par exemple troubler la paix (article 175), participer à un attroupement illégal (article 66 (1)) ou être nu dans l’espace public (article 174). Une personne déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour (article 787 (1)).
[3] Les infractions criminelles les plus graves prévues dans le Code, telles que le meurtre ou la conduite dangereuse causant la mort, sont des actes criminels. Le Code prévoit une peine maximale spécifique à chaque acte criminel et pour certains, une peine minimale est aussi prévue, de façon à ce que le juge ne puisse pas imposer une peine inférieure.
[4] Une grande proportion des infractions criminelles font partie de cette catégorie. Il revient alors au ou à la procureur-e de la poursuite de déterminer, à la lecture du dossier qui lui est soumis, s’il ou elle accusera par voie sommaire ou par voie criminelle. Ce choix aura un impact sur le tribunal compétent, la procédure et sur les peines possibles. Prenons par exemple l’infraction de participer à une émeute en portant un masque : si l’accusation procède par voie sommaire, une amende d’un montant maximal de 5000$ et/ou un emprisonnement de moins de deux ans pourront être imposés, alors que par voie criminelle, un emprisonnement d’au maximum dix ans est possible.