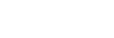Luttons contre les entraves au droit de manifester !
De nombreux règlements municipaux prévoient qu’une manifestation devient illégale dès qu’un acte de violence ou de vandalisme est commis, ne serait-ce que par une seule personne ou un petit nombre de personnes. À titre d’exemple, le règlement 1091 de la Ville de Québec prévoyait qu’une manifestation devenait illégale lorsque des actes de violence ou de vandalisme étaient commis. Cette disposition n’est plus en vigueur aujourd’hui, car elle a été contestée avec succès en 2016 dans l’affaire Bérubé.
Pour sa part, le règlement de la Ville de Sherbrooke, modifié en 2017, interdit à quiconque de participer à une manifestation au cours de laquelle des actes de violence ou des méfaits sont commis par un nombre significatif de participant-e-s, sans plus de précision. Une telle manifestation est alors illégale et doit immédiatement se disperser.
L’interdiction de gestes à caractère violent et le droit de manifester
Pouvoir manifester son opposition ou sa dissidence est essentiel dans une démocratie. Ce n’est pas parce que l’opinion formulée choque ou que le mode d’expression est une source d’inconvénients ou de désordre que l’importance de la liberté d’expression et la liberté de réunion diminue (Garbeau, 2015).
Le fait de mettre fin à une manifestation déclarée illégale ou, parfois, de procéder à des arrestations de masse au motif que des gestes délictueux isolés sont commis par quelques personnes porte atteinte au droit de manifester et à la liberté de réunion pacifique de la majorité. De plus, ce type d’interdiction est susceptible de violer les droits judiciaires des manifestant-e-s, tels que la protection contre la détention arbitraire ou la fouille abusive, le droit de consulter un-e avocat-e sans délai et le respect de la présomption d’innocence.
 Crédit photo : Patrick Sicotte
Crédit photo : Patrick Sicotte
L’interdiction de participer à une manifestation où ont lieu des actes de violence est-elle constitutionnelle ?
Les tribunaux québécois ont déclaré à quelques reprises que les forces policières ne pouvaient pas priver des centaines, voire des milliers, de manifestant-e-s de leur droit constitutionnel de manifester au motif qu’un acte de vandalisme ou une incivilité avait été commis.
De plus, rester sur les lieux d’une manifestation lors de laquelle des gestes illégaux sont posés ne signifie pas qu’on approuve ces gestes. Une démocratie constitutionnelle fondée sur la primauté du droit exige que la détermination de la culpabilité ou de la responsabilité de chacun-e soit établie de manière individuelle (Garbeau, 2015).
L’exercice des droits de la majorité ne peut pas être subordonné à la commission d’actes isolés commis par une minorité d’individus. Dans l’affaire Garbeau (2015) qui a invalidé l’article 500.1 du Code de la sécurité routière, la Cour supérieure a affirmé qu’une « manifestation pouvait être pacifique, même si un petit nombre de manifestants observaient un comportement donnant lieu à la commission d’infractions règlementaires ou criminelles ».
Puis, dans l’affaire Bérubé, il a été clairement tranché qu’une manifestation ne peut pas être déclarée illégale en raison de la commission d’actes de vandalisme ou de violence. Cette décision de la cour municipale de 2016, confirmée en appel en 2019, a invalidé la partie de l’article 19.2 du règlement 10.91 de la Ville de Québec qui pénalisait la participation à une manifestation où sont commis de tels actes isolés. La cour municipale a ajouté qu’il existe des moyens qui portent moins atteinte aux droits constitutionnels, comme des accusations individuelles ou, en cas d’une multitude d’actes de violence, des accusations d’attroupement illégal en vertu du Code criminel. La cour d’appel a confirmé cette analyse en écrivant que « dans les cas où la situation dégénérerait, les règles ordinaires du Code criminel […] suffisent amplement à y pourvoir » (Bérubé, 2019 para. 126).
Le simple fait d’écrire dans un règlement, comme cela a été fait à Sherbrooke, que pour rendre une manifestation illégale, les actes violents doivent avoir été commis « par un nombre significatif de participants » ne corrige pas la lacune constitutionnelle. Les termes employés sont trop imprécis et arbitraires.
Ces décisions québécoises sont conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour européenne) qui a jugé, à maintes reprises, que des actes isolés de violence commis lors d’une manifestation ne pouvaient ni justifier la suppression du droit de manifester pour l’ensemble des manifestant-e-s, ni engager la responsabilité des organisateurs et organisatrices de celle-ci.
Pour la Cour européenne, l’arrestation de masse par encerclement ne peut être d’aucune façon utilisée pour empêcher ou décourager la tenue d’une manifestation ou mettre fin à celle-ci. Les Lignes directrices de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, auxquelles se réfèrent les tribunaux québécois, insistent sur le fait que les membres des forces de l’ordre doivent éviter de traiter une foule comme une masse homogène lorsqu’ils et elles procèdent à des arrestations ou dispersent une manifestation par la force.
Rappelons en terminant que, dès 2006, suite aux représentations de la LDL, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a recommandé que le Canada veille à ce que le droit de chaque personne de participer pacifiquement à des manifestations de protestation sociale soit respecté.